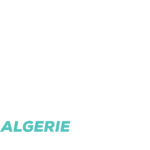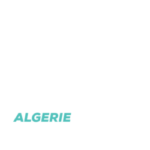« 196 mètres » ou « Algiers » pour le titre international, le premier long métrage de Chakib Taleb Bendiab sort en salles en Algérie, à partir de ce jeudi 5 décembre 2024, distribué par Md Ciné. Ce thriller est basé sur une enquête policière autour d’un mystérieux kidnapping d’une fillette Alger. Dounia (Meriem Medjkane), psychiatre, va travailler en collaboration avec Sami (Nabil Asli) pour trouver l’auteur de l’enlèvement et comprendre ses motivations. Sami est assité de Khaled (Hicham Mesbah) et Nabil (Ali Namous), inspecteurs de police. Le long métrage « 196 mètres » est proposé pour représenter l’Algérie à la 97e édition des Oscars, dans la catégorie du meilleur film international. Le film a remporté le Grand Prix du Festival de Rhode Island aux États-Unis d’Amérique où il a été présenté en avant-première mondiale. Chakib Taleb Bendiab, 42 ans, a réalisé plusieurs courts métrage dont « Black spirit » en 2018. Rencontre.
Votre premier long métrage est sélectionné pour représenter l’Algérie aux Oscars. Est-ce que vous vous attendiez à cette sélection ?
Je ne pensais pas que le film allait aussi loin. Ma première démarche était de faire un petit film, le mieux possible, avec sincérité. Le tournage à Alger a duré 27 jours avec peu de moyens. J’étais accompagné par une équipe technique et artistique exceptionnelle qui a cru au projet notamment les acteurs comme Nabil Asli, Mériem Medjkane, Hicham Mesbah, Ali Namous, Shahrazad Kracheni, Slimane Benouari…Si je n’avais pas cette famille derrière moi, ne je pouvais pas aller aussi loin. Cela nous a mis sur une rampe de lancement. J’ai donc essayé de faire le meilleur film possible quitte à m’endetter pour le finir, emprunter de l’argent pour assurer la meilleure post-production possible. J’étais vraiment fier d’apprendre la sélection du film pour représenter l’Algérie aux Oscars. J’ai pensé à mon père. De là-haut, il aurait été fier de moi de représenter l’Algérie, lui qui était un moudjahid, qui s’est battu pour l’indépendance du pays.
Vous avez opté le polar pour plonger ensuite dans un drame psychologique à plusieurs couches. C’était un choix de départ ?
Oui, c’est ce que je voulais depuis le début. J’ai été biberonné avec les thrillers. Pour moi, il n’y a plus de frontière entre films d’auteurs et films de genre, sinon elle est mince. Le film sud-coréen « Parasite » (comédie noire de De Bong Joon Ho, palme d’or au festival de Cannes en 2019) en est un exemple. Ce film a marqué les esprits et a renouvelé le genre du cinéma américain pour entrer dans autre chose et le relier au film européen classique. J’adore ce mélange de genres. Le public est mûr pour comprendre différents styles. On peut passer de la comédie, au drame, au thriller. Mon rêve est de passer doucement dans un film d’une farce à un drame, à l’horreur…Aujourd’hui, on transcende les genres.
D’où un titre « 196 mètres » qui ouvre la voie à tous les questionnements
Oui, j’ai pensé ce film de cette manière. L’enquête policière me permet d’accentuer les émotions des personnages. L’histoire se passe en 48 heures, il y a un sentiment d’urgence. C’est une métaphore sur l’urgence de l’Algérie. L’urgence de parler ensemble, de construire le pays, le futur. Cela se passe maintenant. C’est une course vers l’avenir même si le film se passe au présent. Je ne voulais pas d’un film sur la décennie noire.
Pourquoi ?
Je pense qu’un travail cinématographique a été déjà fait sur ce sujet. Le plus important pour moi était d’aborder les traumas de la décennie noire, comment vivre aujourd’hui avec ces traumas. L’idée était de faire un thriller, un genre peu exploré en Algérie. Ce n’est pas un style classique. je voulais sortir du film d’auteurs, montrer aux Algériens que les films américains qu’ils regardent et aiment sur Netflix ou autres supports peuvent être réalisés en Algérie avec notre propre vision et notre mise en scène, tout en étant efficace.
Vous avez beaucoup travaillé sur le jeu des comédiens. Les personnages développent une relation forte parfois conflictuelle entre eux, l’inspecteur et son assistant, l’inspecteur et la psychologue…
Les relations sont déjà complexes entre nous. Nous sommes dans un pays où nous n’arrivons pas à nous parler. Je voulais montrer cela dans le scénario. La première version du scénario, écrite en 2018, est la même qui a été tournée. Ce genre de conflits m’intéresse dans l’écriture. Pour moi, le conflit est exhausteur d’émotions. On connait mieux les personnes par les événements, pas par le temps. Je voulais entrer dans le vif du sujet, dans la vraie situation tout de suite. Dans un film, on n’a pas besoin de dire bonjour ou bonsoir, on peut rentrer dans le scène directement.
Vous dites que nous n’arrivons pas à nous parler aujourd’hui. Quelle en est la raison ?
Nous n’arrivons pas à nous parler parce que nous ne faisons pas confiance à l’autre. Si nous avions confiance en nous, confiance en les autres, nous n’aurions pas besoin d’appuyer notre point de vue tout le temps. Mais, il faut avoir confiance en l’avenir. D’où la nécessité d’avoir confiance en les autres. Ensemble, nous pourrons construire l’avenir. Tout seul, on n’y arrivera pas. Dans le film le personnage de Sami dit qu’il a vu des personnes déchiquetées durant les années du terrorisme. Dounia, la psychiatre, lui répond : « je ne suis pas tombé du ciel, moi aussi je vis dans ce pays ». Renvoyer les traumas de chacun ne nous mènera nulle part. Ce qui nous amènera plus haut est de transcender tout cela et de se dire : « qu’allons nous faire maintenant ».
Le film est marqué par des dialogues intenses avec des phrases parfois courtes et incisives…
Pour moi, dans le cinéma, moins il y a des dialogues, mieux c’est. Parfois le dialogue peut cacher le jeu. J’ai écrit plus de dialogues que ce qui a été montré dans le film. J’ai enlevé des dialogues durant les répétitions et le tournage. Si j’ai la bonne émotion et le jeu intérieur que je veux, je n’ai pas besoin de réplique. On le comprend, on le sent. Il faut laisser les personnages dans un mystère même si les spectateurs comprennent les situations. C’est là où réside la subtilité du jeu. On connait les faiblesses du personnage mais on en dit pas trop.
C’est le spectateur qui va rentrer dans sa peau et s’attacher au personnage. C’est cet attachement qui lui permet de suivre l’histoire du film. C’est pour cela que je voulais des dialogues incisives. Parfois, les dialogues sont plus denses pour mieux comprendre l’histoire et son évolution, surprendre le public et laisser l’émotion vivre. Quand le spectateur a toutes les clefs, il est embarqué dans l’atmosphère du film, on peut alors dérouler tout ce qu’on veut. Il est dangereux d’avoir la frustration de ne pas comprendre un film. Il y a des réalisateurs qui disent que si public n’a pas compris un film, c’est tant pis. Je ne suis pas d’accord avec cela. Mon rôle, en tant que réalisateur, est d’amener les spectateurs le plus possible à la clef de la compréhension.
Une bonne partie du film se déroule la nuit. Pourquoi ?
Déjà, il y a le vide la nuit en ville. J’adore jouer sur le contraste entre le clair-obscur, le silence et la musique forte avec des arrêts, le jour/nuit. La ville est peuplée le jour, désertée le soir. C’est durant la nuit que les crimes apparaissent toujours depuis Jack l’éventreur (tueur en série anglais)
Oui, les fantômes de la nuit…
Voilà. Il y a donc un côté énigmatique. On sent qu’Alger a une stigmate, une histoire forte. Je trouvais aussi intéressant de montrer l’architecture urbaine le soir. On comprend que des gens ont vécu dans ces espaces, il y a une vie. On est forcément lié à l’histoire de la ville et du pays avec tout ce qu’ils ont vécu. Malgré le vide nocturne, on sent qu’on est observé, qu’il y des présences. Je trouvais intéressant de souligner la solitude des personnages quelque part…Ils ne se parlent pas, ils sont tous dans leurs bulles. C’est finalement, plus qu’une enquête policière avec dialogue désaccordés. On entre dans la psychologie des personnages. Comment vraiment se parler, rentrer dans la peau de l’autre, se mettre à sentir ce que l’autre ressent. Tous les personnages sont construits de cette manière. Chacun veut quelque chose, veut l’obtenir tout seul. La psychiatre casse la mécanique et impose le travail collectif pour résoudre un problème, mener l’enquête.
C’est finalement, une femme qui s’impose dans un milieu masculin
C’est aussi un hommage aux femmes algériennes. Le personnage de la psychiatre résume toutes les autres femmes, la grand mère, la mère, la sœur, toutes les femmes que j’ai côtoyée toute ma vie. Le responsable de la communication à la DGSN (Direction générale de la sûreté nationale) est une femme. La brigade des mineurs de la DGSN, qui nous a aidée pour faire une immersion avec les inspecteurs, est dirigée par une femme. Je voulais montrer la réalité. Je n’ai pas trafiqué. Il n’y a pas de cliché, ni négatif ni positif. Je voulais juste être réaliste. En fait, la misogynie n’est pas là où on pense. Elle va venir parfois plus du médecin, qui voit la psychiatre comme une infirmière, que du policier qui travaille avec elle. J’ai raconté quelque chose que j’ai vu.
Le film est quelque part un hommage à Alger aussi. La ville est un vrai personnage. Il y a Alger des ruelles, des terrasses, des bâtiments blancs, des rappels bleus de la mer, des petits bruits nocturnes….
Alger dans toute sa splendeur ! C’est aussi la métaphore des classes sociales. On va vers les profondeurs, les caves, les mystères enfouis, chacun a des secrets…Tous le décors ont été réfléchis avec cette vision. A contrario, l’appartement de la psychiatre est en hauteur. Elle est donc d’un autre niveau social. Cela n’empêche pas qu’ils se parlent et qu’ils doivent descendre en bas. Si on veut se parler, il faut que chacun aille vers l’autre. c’est une écriture cinématographique vue de cette manière.
C’est aussi un plaidoyer pour le dialogue et l’échange…
Oui. Le dialogue, l’échange et l’urgence. Il y a l’urgence de le faire maintenant. Nous sommes un peuple accueillants et courageux. Je le répète dans le monde entier dans les festivals. Ce qu’a vécu le peuple algérien pendant la décennie noire est unique. Le peuple s’est relevé et a continué de vivre. A l’époque, les Algériens vivaient presque normalement mais cela laisse des traces, des traumas. Il ne faut pas sous-estimer ces traumas. Parfois, nous ne comprenons pas le comportement de certaines personnes, c’est ce que peut compliquer les choses. Il ne faut pas être insensibles à ce qui nous est arrivé. Au contraire, la force est de regarder ce passé en face. Le passé de la colonisation française, le passé de la décennie noire…Ce qui nous a construit , c’est notre identité. Plus on se parle, plus on construit un futur.
Justement, « 196 mètres » est le premier film algérien qui questionne la phase post-traumatique de la décennie noire.
J’ai trouvé important de poser la question : qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Pense à l’après. Nous avons besoin de comprendre ce qui nous est arrivé pour mieux vivre notre présent. L’histoire du film se passe aujourd’hui avec le kidnapping d’une fille. Et on se rend compte après qu’une autre personne avait été enlevée par le passé. Le passé rejoint le présent pour construire le futur. J’ai utilisé des métaphores. La première couche est l’enquête policière qui permet de suivre la trame. Suivent après un deuxième, puis un troisième thème. Cela rend le film plus profond. C’est ce qui explique peut être que le long métrage soit retenu dans des festivals. J’ai rencontré déjà des publics différents qui ont bien vu ces couches successives dans le film.
Et pourquoi le choix de Nabil Asli pour le rôle principal, un acteur connu par le grand public pour ses rôles à la télévision (El Batha, Dekious ou mekious) ?
J’ai vu les films où a joué Nabil Asli (« Le repenti » de Merzak Allouache, entre autres). Je ne le connaissais pas personnellement. J’essaie de tout voir, films, séries, etc. Il est important de suivre l’évolution des comédiens, suivre leur jeu, leurs techniques. j’essaie toujours de trouver des variations de jeu dans certaines scènes. Nabil Asli a la force des grands artistes. Nabil Asli est un vrai grand comédien. il peut se transformer, s’adapter, comprendre le langage cinématographique. C’est ce que je cherchais, l’intelligence du jeu. J’ai conçu le scénario en pensant à lui. On a parlé et commencé à travailler à distance après lecture du scénario. J’ai pensé tout de suite à Mériem Medjakne pour le rôle de la psychiatre même si j’ai réécrit le rôle car à l’origine la soignante était plus jeune. Je voulais que la psychiatre ait le même âge ou presque que les inspecteurs de police dans le film.
Un film primé et programmé dans plusieurs festivals à travers le monde…
Oui. Nous étions sélectionnés au Festival de Valence en Espagne. Mais l’événement a été reportée en raison des inondations. Nous avons été programmé en Egypte et en Inde. Nous serons bientôt en Tunisie au JCC (Journées cinématographiques de Carthage). Au Canada, nous avons eu un standing ovation pendant quatre minutes dans une salle de 700 personnes pleine. Des Algériens, des ingénieurs, des médecins, des étudiants, sont venus en groupe voir le film. Nous étions fiers de les voir. Les publics nous ont posé des questions intéressantes sur le film avec des débats intenses. J’aime rencontrer les publics différents. Le film devait être projeté au Festival international du cinéma d’Alger (FICA) qui devait avoir lieu fin novembre 2024. Malheureusement, le festival a été reporté. Nous avons insisté pour bien préparer la sortie du film en Algérie au bon moment, pendant que la vague est haute, avec cette nomination aux Oscars. Je voulais absolument que le film sorte prioritairement en Algérie, là où il a été fait et produit. Le public algérien doit voir ce que nous avons récolté à l’international. C’est aussi le succès de notre public.
Vous dites qu’il est important aux Algériens de produire leurs propres histoires, surtout celle relatives à la décennie noire
Il est important de s’approprier notre histoire. Le peuple qui se regarde en face est un grand peuple. Et nous sommes un grand peuple avec une grande Histoire, ne nous l’oublions pas. Notre Histoire n’a pas commencé avec la colonisation française. Je ne vous cache pas que je voulais montrer une Algérie où les gens vivent normalement, ont des téléphones portables, ont une police scientifique…Ce n’est pas juste un âne qui passe dans une rue. Il faut en finir avec ces clichés.
Et le prochain film ?
Le prochain long métrage sera sur l’Histoire de l’Algérie avec ses différents royaumes, ses civilisations, le lien avec l’Andalousie. Depuis quatre ou cinq siècles, la civilisation occidentale est dominante. Mais, d’autres civilisations avaient existé par le passé. Nous sommes issus d’une grande civilisation, c’est juste à quel moment nous devons la raconter. Il ne faut ni se dénigrer ni se croire supérieur aux autres. Pour moi, tous les peuples sont égaux. Il faut savoir raconter notre Histoire, ne pas laisser les autres la raconter à notre place. Restons fiers de ce que nous sommes en respectant tout le monde et en s’inscrivant dans le monde. Nous ne sommes pas seuls. J’aime les relations Sud-Sud. C’était agréable de voir un film projeté en Inde. L’Inde, c’est un grand pays, une grande civilisation, un grand cinéma.