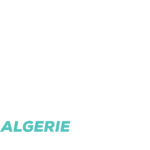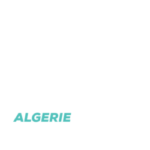L’Institut Français d’Alger a décidé de faire peau neuve en lançant une entreprise de réhabilitation et de modernisation. Le cabinet d’architecture MMA, dirigé par les architectes Achour Mihoubi et Abderrahmane Mahgoun, a décroché le marché. Ils ont eu à intervenir sur un vestige de l’Alger du 19 ème siècle. Réalisé à partir de 1880 par le génie militaire, il sert de caserne d’intendance jusqu’en 1962. Explications avec Achour Mihoubi dans cet entretien accordé à 24h Algérie.

24H Algérie : Vous avez remporté le marché de la réhabilitation de l’IFA qu’est-ce qui vous a distingué à votre avis de vos concurrents ?
Achour Mihoubi : Notre approche a consisté à répondre aux orientations programmatiques du maître d’ouvrage; celui-ci voulait, dans le cadre de cette consultation architecturale à laquelle nous avons été conviés avec trois autres concurrents, marquer par un apport architectural marquant une identité visuelle au futur centre de l’Institut d’Alger. Il faut savoir que l’institut d’Alger est le plus important des cinq instituts français en Algérie. Il comprend plus de 3000 m² de surface couvertes contenues dans trois bâtiments agencés autour d’une grande cour centrale. Ses bâtiments sont demeurés avec leur architecture initiale dessinée par les ingénieurs du génie militaire à la fin du 19e siècle. Notre idée était portée principalement par deux points. Premièrement, créer un volume transparent pour marquer l’entrée de l’institut qui abrite par là même le service d’accueil. Deuxièmement, déployer la toiture du comble du bâtiment central en surélevant de manière à rendre exploitable la totalité des espaces sous combles qui étaient mal aérés et sombres en triplant sa surface et en permettant à l’institut d’y installer la quasi-totalité de son service de gestion. Ces deux touches ont fait « mouche »! C’est ce qui a pesé dans la décision finale du maître d’ouvrage.
Quelles ont été vos principales sources d’inspiration pour ce projet de réhabilitation ? Avez-vous intégré des éléments culturels ou historiques spécifiques du pays d’accueil dans votre conception ?
La mission n’a pas été simple, étant donné qu‘il a fallu trouver la juste teneur entre l’architecture d’un ensemble de bâtiments du 19ème siècle, qui a servi de caserne jusqu’à 1962 avec ses ordonnancements, ses rapports rigoureux pour ne pas dire austères propres aux bâtiments militaires, et un apport qui soit moderne sans pour autant déranger l’architecture de l’ensemble. Le nouveau couronnement du bâtiment principal avec une toiture légère en courbe assez aérienne pour dégager, tout en les mettant en valeur, les frontons d’évocation classique des façades latérales du bâtiment. L’inspiration était simplement une plus grande mise en valeur de l’architecture du bâtiment en mettant en opposition le volume vitré qui le couronne avec le corps massif du bâtiment.
Pourriez-vous nous expliquer le concept architectural global de la réhabilitation ? Quels sont les éléments clés qui caractérisent votre vision pour cet espace ?
Très brièvement la réhabilitation architecturale consiste à apporter des changements dans l’architecture d’une structure existante pour les besoins d’un nouveau programme d’utilisation. En ce qui nous concerne cette mission a porté sur les objectifs suivants:
- Réaménagement de l’entrée de l’institut avec création d’espace d’attente et de réception
- Rénovation de la toiture de la médiathèque avec exploitation des combles en offrant une surface utile plus importante
- Réaménagement des espaces de la médiathèque
- Agrandissement de l’espace cafétéria-restaurant
- Réaménagement de la cour extérieure avec dépose des blocs préfabriqués
- Réaménagement des bâtiments de l’administration.

Comment avez-vous réussi à trouver un équilibre entre l’intégration d’éléments modernes et la préservation de l’histoire et du patrimoine de l’Institut ?
Nous sommes intervenus sur le bâtiment de manière ponctuelle en intégrant des éléments modernes, tout en veillant sur une intégration subtile et assez lisible. La mission n’a pas été simple, il a fallu concilier une volonté de préservation de l’ensemble et le besoin du maître d’ouvrage de donner au futur institut un nouveau cachet imprimant le renouveau de la politique des activités culturelles qu’il est appelé à abriter. L’exercice a consisté à donner aux extensions réalisées, c’est-à-dire le nouvel espace d’accueil et le troisième étage du bâtiment de la médiathèque, assez de contraste sans pour autant être amené à rompre l’ordre ancien.
Quelles mesures écologiques et durables avez-vous mises en place dans la conception ? Comment votre approche répond-elle aux enjeux environnementaux actuels ?
Afin de répondre aux enjeux écologiques, nous avons procédé comme suit:
- Matériaux éco-responsables : Utilisation de matériaux recyclés tel que le bois, panneaux acoustiques.
- Efficacité énergétique : utilisation de luminaires LED, choix de profil et vitrage réduisant les déperditions, équipements éco-performants.
- Organisation fonctionnelle : Mise en place d’un aménagement prenant en charge l’orientation, la ventilation naturelle, minimisant l’usage des équipements de traitement d’air …etc.
Avez-vous prévu des espaces flexibles pour répondre à la diversité des activités culturelles et artistiques qui auront lieu dans l’Institut ? Si oui, comment ?
Oui, nous avons conçu des espaces flexibles adaptés à la diversité des activités culturelles et artistiques au sein de l’Institut. Ces espaces polyvalents intègrent des ateliers d’arts, salle d’exposition, un espace extérieur de 500m² permettant d’accueillir divers événements.

Avez-vous intégré l’accessibilité dans votre conception pour garantir que tous les publics puissent profiter des installations ? Si c’est oui comment ?
Tous les paramètres ont été pris en charge lors de la conception, il est important pour nous de créer des espaces accessibles à tout type de public tout en respectant les normes sécuritaires en vigueur.
Nous avons mis en place divers installations : ascenseurs, place PMR dans l’auditorium, réajuster les niveaux d’accès pour les chaises roulantes etc.
Quels types de matériaux et de techniques de construction avez-vous choisis pour ce projet, et pourquoi ? Comment cela impacte-t-il l’esthétique et la durabilité du bâtiment ?
Les matériaux utilisés ont été choisis de manière à répondre aux conditions de confort et d’exigence du client. Pour les espaces administratifs, la combinaison de ces matériaux a été faite pour assurer le maximum de confort, notamment acoustique, dans les espaces de travail ; A telle enseigne que les nuisances sonores extérieures ont été réduites à zéro dans les bureaux. L’étude acoustique de l’auditorium a exigé qu’on apporte des matériaux spécifiques, bois et membranes de feutre, moquette, ce qui a donné un confort indéniable aux public et surtout à la qualité du son dans cet espace. Pour la salle d’exposition, nous avons apporté des aménagements spéciaux sur les murs extérieurs pour assurer une polyvalence dans l’utilisation. Des panneaux en bois amovibles fixés aux fenêtres permettent à la fois de les obstruer pour les besoins d’une exposition temporaire ou bien de les ouvrir pour laisser entrer la lumière pour en faire une salle de réception par exemple.
Avez-vous collaboré avec des artistes ou des experts culturels lors de la conception ? Si oui, comment leur contribution a-t-elle influencé le projet ?
Les interventions des artistes ont consisté en des peintures sur murs et la pose d’une sculpture au centre de la cour extérieure. Cette contribution a été faite indépendamment de notre mission. La conception générale des espaces a été du ressort exclusif de notre cabinet. Un partenaire engagé par le maître de l’ouvrage s’est chargé de l’étude du mobilier et des appareillages d’éclairage.
Comment le design de l’Institut s’intègre-t-il dans son environnement urbain ? Y a-t-il des considérations spécifiques liées à l’espace public alentour ?
Au niveau de l’entrée principale du projet nous avons remplacé une grande porte métallique déplaisante par un cube en verre de huit mètres de haut pour créer une continuité visuelle entre la rue et la cour intérieure de l’institut. En remplaçant une obstruction inappropriée par une transparence, nous contribuons un peu à continuer l’espace de la rue à l’intérieur de l’Institut et y inviter par la même les passants à y entrer. C’est un peu donner l’image de l’ouverture de la culture sur l’espace public.

Comment envisagez-vous que ce projet évolue dans le temps ? Quelles sont vos attentes concernant l’impact de cette réhabilitation sur la communauté locale et sur le rayonnement de l’Institut français à l’international ?
Cela dépendra des chargés de la politique culturelle française à l’international. En tant qu’architecte investi d’une mission précise nous avons œuvré sur la base d’un programme à donner à cette structure plus de potentiel, que ce soit sur ses capacités d’accueil que pour les commodités qu’elle offre aux usagers des lieux. Dans la limite des capacités des lieux nous avons travaillé à optimiser au maximum les services qu’il peut abriter. Que ce soit en surface qu’en confort thermique, acoustique et visuel.
Pour quand est prévu la livraison du projet et sa réouverture au grand public ?
Bien qu’il soit déjà utilisé partiellement, l’ouverture au grand public est prévue pour la fin de l’année 2024.