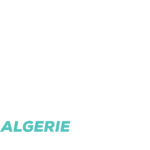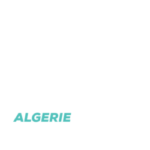Dans Zinet, Alger, le Bonheur (2023, 57 min), Mohammed Latrèche, accompagné de la voix off du jeune écrivain Salah Badis, signe un documentaire aussi émouvant qu’essentiel, ressuscitant la figure de Mohamed Zinet (1932-1995), comédien et cinéaste algérien au parcours aussi riche que tragique.
Projeté en avant-première ce soir à la Cinémathèque d’Alger, en présence du réalisateur, du ministre de la Culture Zouhir Ballalou, et d’un nombre important d’artistes et de cinéphiles, le documentaire a tenu en haleine une assistance captivée par un artiste aussi magnétique que son film.
À travers son unique œuvre, Tahia Ya Didou, sortie en 1971 — fresque poétique célébrant la Casbah d’Alger —, Zinet avait capturé l’âme d’une ville et d’une époque, offrant au cinéma algérien une œuvre viscéralement libre, audacieuse et novatrice. Mais ce film, véritable « comédie inclassable, pleine de vie et de fantaisie » selon les mots de Latrèche, fut longtemps malmené, relégué aux oubliettes, victime d’une sortie chaotique et de copies rapidement devenues inexploitables.
C’est dans l’effervescence du Hirak de 2019, ce printemps algérien marqué par une soif de liberté et de mémoire, que Latrèche entreprend une quête presque chimérique : retrouver et revoir Tahia Ya Didou. Cette recherche, semée d’embûches — rareté des copies, version restaurée introuvable — devient un écho subtil aux luttes contre l’amnésie collective. Le film de Latrèche se fait alors palimpseste : il superpose les mémoires d’un homme, d’une ville et d’une nation, dans un éternel recommencement des combats pour la vérité et la transmission.
Mohamed Zinet apparaît comme un électron libre, un artiste insaisissable dont la vie épouse les soubresauts de l’histoire algérienne. Dès ses débuts sur les planches, sous la colonisation, il incarne Tibelkachoutine, un clown impertinent inspiré de Charlie Chaplin, avant de s’engager dans la lutte anticoloniale au sein de la troupe artistique du FLN. Après l’indépendance, en 1969, à la demande du professeur Bachir Mentouri, président de l’APC d’Alger, il entreprend un film destiné à promouvoir la ville, transformant ce projet initial en une œuvre hybride, mêlant fiction et fragments documentaires. Tahia Ya Didou, ou Alger insolite, naît ainsi, porté par l’énergie brute de la Casbah et de figures comme Himoud Brahimi, dit Momo, l’amoureux d’Alger. Comme le souligne Boudjemaâ Karèche, ex-directeur de la Cinémathèque d’Alger, ce film « a inscrit Alger dans le monde », saisissant une ville rarement filmée par les Algériens eux-mêmes.
Pourtant, Zinet reste un « cinéaste empêché ». Frustré par un système de production étatisé, il ne réalisera jamais d’autre long métrage, et son rêve d’adapter Tibelkachoutine au cinéma s’évanouira. Son parcours, jalonné de combats — de la guerre de Libération à l’exil en Tunisie, en Allemagne puis en France —, s’achève dans la douleur, à l’hôpital psychiatrique de Charenton, en 1995. Latrèche, qui a consacré plus d’une décennie à traquer les traces de cet artiste oublié, livre un travail de détective, recomposant un puzzle aux pièces manquantes, entre témoignages épars et silences de l’histoire.
Zinet, Alger, le Bonheur n’est pas seulement un hommage. C’est un film sur le cinéma comme lieu de mémoire, individuelle et collective, où se croisent la joie espiègle des enfants de la Casbah et les blessures d’une nation. Les images du Hirak, vibrantes d’espoir, se mêlent aux archives restaurées de Tahia Ya Didou, rappelant que le bonheur, comme la lutte, est un éternel recommencement. À travers ce dialogue entre passé et présent, Latrèche célèbre un cinéma qui refuse l’oubli, et un homme dont la fragilité n’a d’égale que le courage. Une œuvre à découvrir, et à faire découvrir.