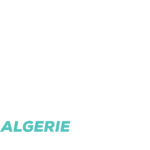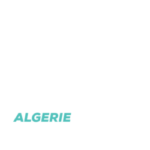Des Algériens qui « découvrent » l’utilisation des armes chimiques par l’armée coloniale française en Algérie ? Hosni Kitouni n’est guère surpris par cette amnésie nationale qui ne réagit qu’à ce qui se fait en France . Il explique les ressorts de cette émotion des Algérien voyant , en fin, des compatriotes dire directement et avec leurs mots, des horreurs de la colonisation. Mais avertit-il, une fois de plus , au-delà de l’émotion, il y a du travail à faire.
Affirmer comme le fait un journaliste algérien que « c’est l’un des derniers tabous de la guerre d’Algérie », après la diffusion du film “Algérie, sections armes spéciales” réalisé par Claire Billet, n’est pas tout à fait exact, comme ne l’est pas non plus l’assertion selon laquelle ces faits avaient été jusque-là « passés sous silence » ? En réalité le film est une nouvelle péripétie dans une longue historie aux multiples soubresauts qui a connu son point culminant en 2022 quand l’historien français Christophe Lafaye a décidé d’alerter l’opinion sur les entraves mises par l’administration du service des archives du ministère de la Défense français (SHD) l’empêchant de consulter des documents nécessaires à ses recherches sur les sections armes spéciales de la guerre d’Algérie.
L’historien se confie alors à la journaliste Claire Billet, un article sous le titre évocateur « la guerre des grottes » est proposé à la Revue XXI. Annoncé dès le 22 mars par une émission de France culture, l’article (paru le 1er avril) est relayé par l’association « Josette et Maurice Audin » et la Ligue française des droits de l’homme. Un appel est lancé lors d’une conférence de presse, pour « l’ouverture d’archives sur l’utilisation d’armes chimiques par l’armée française ». La presse et les médias se sont ensuite saisis de l’affaire en Algérie. El Moudjahid notamment lui consacre un numéro spécial de sa revue Politis. De manière générale, le ton de la presse nationale est à l’émotion et à la dénonciation victimaire. Ensuite plus rien…nulle suite pratique..
Contrairement aux assertions de la presse, on parle de « révélations », d’«épisode inconnu» de «crime caché», l’usage des gaz létaux en Algérie comme technique de guerre, comme action de terrain a continué après 1962 à faire l’objet en France d’études de retour d’expériences, de témoignages, et de procès en demande de réparation de la part de ses victimes françaises.
Une affaire connue de longue date
Un récit bien documenté sur les « sections grottes » est livré par Roger Clair en 1998 dans son livre Commando spécial. Algérie 1959-1960. Appelé du contingent, volontaire pour servir dans les « unités spéciales », l’auteur relate comment des « sections de génie spécialisées furent mises en place pour réduire [les] fortifications naturelles par l’emploi d’explosifs et de gaz de combat ». En 2003, Armand Casanova publie Ma Guerre des grottes en Algérie où il consacre plusieurs chapitres aux commandos grottes du génie en grande Kabylie. D’autres témoignages s’en suivent sur le sujet comme celui du lieutenant Michel Schoultz consacré à la « section grottes » de la 75e compagnie du génie aéroporté. Ou encore en 2017, le livre de Triolet Jérôme et Laurent, La guerre souterraine. Sous terre, on se bat aussi.
Au sein de l’armée, l’expérience algérienne est mise à profit, le centre de renseignement terre, relevant du commandement du renseignement, unité militaire de l’Armée de terre française consacre en 2018 un dossier largement documenté à La guerre souterraine. L’expérience algérienne y est qualifiée « des plus fructueuses » : « ses enseignements ont souvent été mis à profit lors des conflits des années 1990 et 2000 et aujourd’hui encore, le concept de la FO [fouille opérationnelle] trouve ses bases dans l’expérience acquise à cette époque. » Le cahier du RETEX (publication relevant du centre de Doctrine d’enseignement du commandement de l’armée française, ministère de la Défense) rappelle que cet épisode « de la guerre d’Algérie permet à l’armée française de se doter d’une expertise certaine dans le domaine de la lutte et de la fouille en milieu souterrain ».
Plus significatif encore, dans un article daté d’avril 2019, sous le titre « Histoire du génie combat contemporain épisode 4 – Le génie en Algérie: l’école de la lutte antisubversive (1954-1962) » c’est l’historien de l’armée Christophe Lafaye, qui expose les détails de la stratégie de la guerre des grottes :
« A l’été 1959, ces commandos sont formés à l’utilisation des gaz auprès de la batterie « armes spéciales » (BAS) du 411e Régiment d’Artillerie antiaérienne (RAA) à Sidi Ferruch. Cette unité, créée le 1er décembre 1956, est pionnière dans l’utilisation de l’arme chimique en Algérie. Des procédures d’actions sont définies à partir des expériences empiriques des capacités précédentes et de l’intégration de nouveaux vecteurs de lutte, comme le gaz lacrymogène et le DM. De nouvelles munitions à gaz mélangeant les deux principes actifs (CN et DM) donnent naissance au CN2D ».
Ces recherches trouvent leurs prolongements sur les terrains opérationnels de la guerre impériale menée par la France et ses alliés.
C’est ainsi qu’en 2001, au moment où l’Armée américaine cherche un moyen pour neutraliser Ben Laden, réfugié dans les grottes de Bora Bora (Afghanistan), les experts militaires français préconisent tout simplement de « gazer les grottes » comme le faisait la France « Contre les fellagas durant la guerre d’Algérie ». Les Français écrit le journal Libération « ont dû former des «équipes de grottes» pour lutter contre l’Armée de libération nationale (ALN) algérienne [qui] utilisait les cavités naturelles de la montagne pour s’y réfugier, y installer des hôpitaux ou y stocker des armes », les soldats français avaient « à l’époque, utilisé des gaz de combat pour en déloger les fellagas ».
Ce qui s’est passé en Algérie est devenu un savoir-faire transmissible au sein de l’armée française, tout en masquant son côté destructeur sur les populations et l’environnement. Tel est par exemple le biais de l’étude d’Olivier Lion consacrée à l’usage « Des armes maudites pour les sales guerres » durant la période 1918-1990, qui ne fait aucune allusion à la guerre chimique de la France en Algérie.
Pourquoi le film, qui reprend pourtant des informations connues depuis 2022, a-t-il provoqué une profonde émotion et une indignation du public, et la presse parle de nouveau de « tabou d’État » et de « révélation » comme si l’épisode de 2022 n’avait pas existé ? Pourquoi notre mémoire collective est-elle, à ce point, défaillante ?
Pourquoi tant d’émotions
Il y a bien sûr le contexte anxiogène de la crise algéro-française ; le rôle des réseaux sociaux, la déprogrammation du film, etc. Tous facteurs qui se sont surajoutés à l’impact de l’image filmique par rapport à l’écrit. Mais au-delà de ces éléments factuels, l’émotion vient surtout du fait que le film se présente comme un récit du vécu des victimes. La première image, est à cet égard très évocatrice : un Algérien avance dans un paysage aurassien pour nous amener sur le lieu du crime. S’n suivent des récits bouleversants des souffrances encore vivaces. Le film parle donc de Nous, Algériens victimes de la guerre chimique qui a détruit les nôtres et pollué notre environnement ! Il ne s’agit plus de technique de guerre, mais de notre passé, celui de nos familles, de nos femmes et de nos enfants étouffés atrocement dans des grottes qui jouxtent nos villes et nos villages.
Ce changement de la perspective narrative qui place la victime au cœur du récit est l’une des causes qui ont donné au film son impact émotionnel. Or là aussi, on ne peut que constater combien nous sommes les mauvais élèves qui refusent d’apprendre de leur propre histoire. Car la guerre chimique n’est pas un sujet inconnu en Algérie, c’est un passé-présent qui n’a pas eu ses historiens, ses écrivains, ses réalisateurs, ses transmetteurs.
Écrire une histoire algérienne
Déjà dans le feu de la guerre de libération, le président du GPRA, M. Ferhat Abbes , à la suite du gazage de toute une tribu, le 14 mai 1959 adresse le télégramme suivant à la Croix-Rouge internationale :
« Me permets vous dénoncer une fois de plus représailles Armée française contre populations civiles en Algérie – stop – Récemment au douar Terchiouine aux environs Batna une centaine personnes dont beaucoup femmes et enfants se sont réfugiées dans une grotte pour échapper ratissage – stop – Toutes ont péri asphyxiées par gaz – stop – vous demande joindre vos protestations aux nôtres et rappeler aux responsables Armée française respect lois guerre et conventions internationales. »
Dans sa dépêche depuis Tunis l’Associated Press donne le chiffre de « 112 Algériens, en majorité des femmes et des enfants réfugiés dans une grotte, attaqués à la grenade asphyxiante ».
La grotte en question Ghar-Ouchettouh est ouverte après l’indépendance. Des restes de martyrs y ont été retrouvés et ensuite inhumés. Grâce à la collaboration de la population, ces martyrs ont été identifiés, on connait aujourd’hui leur nombre et leurs noms figurent sur une stèle commémorative. L’universitaire algérienne Rahma Rahima a documenté cette opération et l’infatigable patriote Abdelhak Benzaid a publié des récits et des documents d’archives sur sa page Facebook, éclairant cet épisode.
Le 2 janvier 2017 fut mise au jour des chouhadas dans la grotte de Boucif à Djabel El Taraf, commune de Oum El Bouaghi.
En juillet 2020 les moudjahidines de Tissemssilt ont exploré la grotte Ghar Layachine, où 1959, plus de 80 moudjahidine et civils ont trouvé refuge pour échapper à une vaste opération de ratissage de l’armée française. Tous ont péri « par suite d’une attaque par une section grotte usant d’armes chimiques et d’explosifs ».
Toujours à la même période, mais dans une autre région, à Khenchela, Maghrat Djemri a livré les restes de 25 martyrs, le squelette de l’un d’eux se trouvait en position assise, collé contre la paroi tel que surpris par la terrible mort.
C’est entre 8000 et 10.000 grottes qui ont fait l’objet de gazage, Christophe Lafaye en a documenté plus de 400, c’est dire l’ampleur des désastres écologiques et humains consécutifs à ces crimes de guerre de la France en Algérie.
Et c’est là où la vraie question se pose : pourquoi l’émotion suscitée en 2022, n’a-t-elle pas été suivie par une prise en charge institutionnelle de la guerre chimique comme élément important dans le plaidoyer national contre les crimes de la colonisation ? Pourquoi aucune entreprise d’investigation et d’action en vue d’identifier ces grottes dans une politique générale de protection de l’environnement et de préservation de la mémoire nationale ? Pourquoi, nos émotions ne nous ont-elles pas conduits à l’action de savoir et de restitution de ce passé? Les historiens dont le rôle est précisément de cultiver la mémoire des vivants envers leurs morts, pourquoi ont-ils manqué de réactivité ?
Est-ce que sitôt passée l’intensité de l’émotion provoquée par le film, nous allons de nouveau tout oublier ? Trois taches s’imposent, elles relèvent d’un devoir national !
- Sur le plan juridique : Nous sommes là en présence d’éléments constitutifs de crimes de guerre perpétrés par la France coloniale en Algérie. En effet, l’usage des gaz létaux dans la guerre a été interdit par le Protocole de Genève du 17 juin 1925, qui est entré en vigueur le 8 février 1928. Ce protocole interdit l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues ». La France a signé le Protocole de Genève, le jour de son adoption, et l’a ratifié rapidement. Il
- Sur le plan historique, il y a un immense chantier de recherche pour documenter cette guerre à partir des archives françaises, des témoignages des populations pour identifier les grottes, les victimes, les épisodes, et construire une histoire de cette guerre implacable menée au peuple algérien, sans oublier les résistances développées par le génie populaire pour contrecarrer les effets de cette guerre.
- Sur le plan mémoriel, il faut inscrire les grottes mises au jour dans le circuit mémoriel de la guerre de libération nationale, afin de sauver de l’oubli les souffrances et les vicissitudes de notre peuple en lutte pour sa liberté.
Ainsi et seulement ainsi nous établirons notre propre agenda mémoriel et historique. Gloire éternelle à nos martyrs.