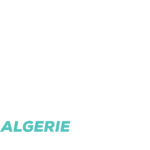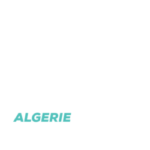Il y a une sorte de justice immanente qui vient rappeler aux puissants de ce monde qu’ils ne peuvent indéfiniment se soustraire à leurs crimes envers ceux que les circonstances ont momentanément privés de leur pouvoir de défendre. Est-ce ainsi qu’il faut interpréter ce qui s’est passé en 2004, 2020, 2022 quand l’Europe et la France, particulièrement effarés, se trouvent couverts par les sables contaminés de Césium-137 issus des essais nucléaires français des années 1960 au Sahara algérien. Laissons-nous accroire à cette vengeance de la nature puisque celle des hommes est devenue semble-t-il de mauvais aloi.
Ce que nos concitoyens et notre pays vivent depuis 1960, à cause des effets terrifiants des essais nucléaires longtemps couverts par le secret ou l’indifférence, est devenu une réalité menaçante y compris pour l’Europe. Or ces menaces pour l’environnement et la santé publique, les Algériens et les experts de l’Agence de l’énergie atomique n’ont cessé d’en alerter l’opinion. En effet, des enquêtes de terrain effectuées depuis des décennies et qui ont fait l’objet de nombreux rapports ont montré que « les déchets immenses très radioactifs et de longues vies, certains sont enfouis sous terre et d’autres sont laissés à l’air libre, sans oublier les radiations répandues sur de vastes surfaces, causent un grand nombre de victimes parmi la population locale et des dégâts à l’environnement qui perdurent hélas jusqu’à nos jours ».
La menace n’est ni localisée ni passagère, comme l’ont été les onze millions des mines antipersonnelles plantées sur nos frontières Est et Ouest, et qui ont pu grâce à l’engagement de l’ANP être neutralisées au bout de 55 ans d’efforts continus. Là aussi, ce sont 4.000 morts et 13.000 blessés de nos concitoyens qui ont payé le refus de la France de fournir toute aide technique pour hâter le déminage. Les cartes et plans de sites minés n’ont été remis à l’Algérie par la France qu’en… 2007, autant dire trop tard !
La radioactivité pose des problèmes comparativement plus complexes et plus graves que les mines, leurs effets sur la santé humaine et l’environnement sont plus pérennes et plus nocifs. Pour décontaminer, il faut non seulement disposer de la technologie nécessaire en plus d’informations fiables sur les sites, la nature des matières enfouies, leur importance et leur localisation. Autant de données dont l’Algérie ne dispose pas, malgré les multiples demandes faites à la partie française. Or l’absence de cartes rend le travail très difficile et bien plus couteux. État des lieux !
La France est devenue puissance nucléaire depuis l’Algérie
Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 explosions nucléaires au cœur du Sahara, 4 atmosphériques dans la zone de Reggane et 13 à flanc de montagne Tan Affela près d’In Eker. De plus, il faut ajouter 40 essais « sous-critiques » qui ont dispersé des matières radioactives, notamment du plutonium, mais sans déclenchement d’une réaction en chaine. En plus des sites d’essais de Reggane et d’In Ekker, la France disposait au Sahara d’un troisième site sur lequel très peu d’informations ont encore filtré: la base B2-Namous, où elle procédait à des expérimentations d’armes chimiques et des systèmes de propulsion, notamment pour les missiles… Il semble, comme l’affirme Vincent Jauvert dans son article « Nom de code : B2 Namous. Quand la France testait des armes chimiques en Algérie » que ces essais se soient poursuivis jusque dans les années 1980.
La puissance totale des 17 bombes qui ont explosé au Sahara, représente pas moins de 600 kilotonnes de TNT, soit 40 fois la bombe d’Hiroshima !
C’est seulement en 1966 que la France a cessé ses essais au Sahara pour se transporter en Polynésie. Sauf que les deux sites de Reggane et d’In Ekker ont été remis à l’Algérie sans qu’aucune modalité de contrôle et de suivi de la radioactivité ait été prévue. Plutôt que rapatrier le matériel contaminé et les déchets issus des explosions, la France a décidé de les enfouir sur place ou encore de les abandonner à la surface. Mohamed Bendjebbar, alors officier du génie responsable de la prise en charge du démantèlement de la base de Reggane, a témoigné publiquement à plusieurs reprises « que l’autorité française avait procédé à l’enfouissement de matériel, outillages, moyens mécaniques ayant servi et susceptibles d’être contaminés sur deux sites: le premier à dix kilomètres au nord-est du plateau de la base-vie, le second à cinq kilomètres du point zéro. Quant aux autres déchets hautement radioactifs, ils auraient été placés dans des bunkers bétonnés ».
Des enquêtes sur le terrain faites par des observateurs et des journalistes ont révélé que sur les différents sites ont été abandonnés des bidons de bitume, aluminium, tôles, des centaines de fûts métalliques entourés de simples barbelés, des câbles électriques, ferrailles, tuyaux, conduites d’eau tous restés éparpillés sur le sol sur plusieurs hectares. Les témoignages de militaires indiquent que des objets utilisés lors des essais ont été enfouis à quelques centimètres sous le sable.
Mais le plus grave, et qui constitue une menace terrifiante sur l’environnement et les populations, ce sont les matières hautement radioactives qui ont été stockées sous le sable. À In Ekker par exemple, il y a eu « un stockage de déchets radioactifs de roches contaminées extraites des galeries dans le flanc sud du Tan Afella, en un endroit entouré d’une enceinte sommaire ».
Selon les données publiées par l’Agence internationale de l’énergie (AIEA), la zone Béryl contaminée « à l’origine correspondait à 250 hectares », comprenant 2,5 hectares situés sur le versant du Tan Afella – ou se trouvent les fameuses coulées de lave et de scories –, des espaces qui « n’ont pas été [traités] et sont certainement en l’état ».
Du côté algérien, depuis les années 1980, les spécialistes en environnement et en énergie atomique, n’ont cessé de réunir des données in situ afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations, mais également pour évaluer la menace sur l’environnement. L’expert algérien Amar Mansouri, un des meilleurs connaisseurs de la question, souligne « la gravité des radiations nucléaires responsables de différents cancers et de malformations congénitales » outre leur impact sur l’environnement, le chercheur a qualifié ces explosions de « crime majeur contre l’humanité ainsi que la faune et la flore ».
Et il n’est pas le seul à le dire. Concluant son étude, le spécialiste Patrice Bouveret écrit « C’est bien là qu’on se retrouve confronté au problème de la responsabilité «criminelle» de l’État français qui est parti sans rapatrier ses déchets ni baliser les zones contaminées pour les rendre inaccessibles aux populations. De plus, il n’a pas non plus transmis au gouvernement algérien un état des lieux et une cartographie des zones dangereuses à surveiller. Une telle attitude ne permet pas d’assurer la sécurité sanitaire des personnes ni ne contribue à apaiser les tensions. »
Responsabilité criminelle de l’État français
Soixante-cinq ans après le début de ces essais, l’Algérie paie encore aujourd’hui le prix de ce qui a permis à la France de devenir la puissance nucléaire qu’elle est. Devant l’ampleur des revendications des associations algériennes défendant les intérêts des victimes, mais également sous la pression des associations polynésiennes une loi fut votée par le Parlement français en 2010 (loi Morin) comportant des dispositions pour indemniser les victimes des effets radioactifs au Sahara et en Polynésie.
Pour être reconnu victime, « Il faut, souligne un officiel français, prouver que vous étiez à un endroit extrêmement précis pendant une période précise où il y a eu ces essais nucléaires et ça, ce ne sont pas forcément des choses, des documents, dont les gens peuvent disposer. Les populations du sud algérien sont souvent nomades. Les victimes ou les ayants droit peuvent aussi avoir des problèmes pour faire reconnaitre les maladies. La France ne reconnait que 23 types de cancers. Eux n’arrivent peut-être pas à prouver ou à montrer correctement, du fait du manque d’infrastructures sanitaires, qu’ils souffrent de tel ou tel type de cancer ».
Depuis 2010, sur les 40.000 personnes censées avoir été localisées à proximité des sites contaminés en Algérie, seulement 66 dossiers de victimes ont été déposés au CIVEN (Comité français d’indemnisation des victimes des essais nucléaires) et une seule personne a été reconnue comme étant victime directe des essais français dans le sud du Sahara.
Quant aux revendications de l’État algérien pour décontaminer les sites des essais nucléaires, la France a toujours répondu par des promesses non tenues. Suite à la visite du président Nicolas Sarkozy en décembre 2007, « un comité algéro-français a été annoncé… Son but : établir un état des lieux sur les sites pollués afin d’en diagnostiquer la radioactivité, d’en déterminer les risques sur les habitants et l’environnement et proposer des mesures de réhabilitation ». Comité mort-né ! 2014, un nouveau groupe de travail algéro-français a été mis en place en application de la « Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie », signée le 19 décembre 2012 lors la visite du président François Hollande, avec cette fois comme objectif d’échanger sur les conditions de présentation des dossiers d’indemnisation pour les victimes algériennes. Le comité s’est réuni UNE seule fois le 3 février 2016 ! Et puis pschitt.
Le rapport de Benjamin Stora de 2020 remis au président E. Macron sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » évoque vaguement la question des effets des essais nucléaires. Dans ses préconisations, l’affaire est réduite à ces deux lignes : « La poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences ainsi que la pose des mines aux frontières. » Pose des mines aux frontières, dit-il alors que le travail de déminage a été achevé depuis trois ans ! Quant à la contamination des zones saharienne, il la renvoie aux comités morts nés.
Qu‘and‘en est-il pour la partie algérienne ?
Dans une déclaration récente le président de la République a appelé la France à « venir nettoyer, je ne veux pas de votre argent, je n’ai rien à faire avec votre argent ». La décontamination est donc pour l’Algérie une question importante sinon essentielle. Allant dans le même sens le Sénat algérien a voté en janvier 2025 une loi demandant à la France d’ « assumer pleinement ses responsabilités » dans « l’élimination des déchets radioactifs ».
Faut-il devant cette obstination de la France à ne pas remplir ses obligations, faire de cette question une conditionnalité de la « réconciliation » préconisée par certains acteurs en France comme en Algérie ? On ne peut que l’espérer, car la France, les Algériens ont appris à la connaitre depuis 1830.
Jamais elle n’a su respecter ses engagements solennels ! Ne s’est-elle pas soustraite au paiement de sa dette de blé contractée par Napoléon ? N’a-t-elle pas trahi les termes de la convention du 5 juillet 1830 de « respecter les propriétés, la religion des musulmans » ? N’a-t-elle pas renié les traités signés avec l’Émir Abdelkader celui de 1834 (Desmichels) et celui de la Tafna (1837) ? Nous pouvons ainsi égrener à n’en plus finir ses faux bonds faits successifs.