À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de la première explosion nucléaire à Reggane, la question de la reconnaissance et de la réparation des victimes resurgit avec insistance. Deux figures majeures de l’État algérien, Salah Goudjil, président du Sénat, et Brahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale (APN), ont vivement dénoncé l’héritage radioactif laissé par la France et exigé qu’elle assume pleinement ses responsabilités.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Salah Goudjil a qualifié ces essais de « l’un des crimes d’extermination les plus atroces », soulignant que la catastrophe nucléaire de Reggane continue de faire des ravages : « La honte enfouie sous le sable répand encore son poison et engendre de nouvelles victimes, en raison de l’irresponsabilité du néocolonialisme. »
De son côté, Brahim Boughali, lors d’une journée d’étude organisée par l’APN sous le thème « Explosions nucléaires en Algérie : un crime contre l’humanité et l’environnement », en présence de membres du gouvernement, de représentants d’organismes officiels et de parlementaires, a rappelé que les 17 essais nucléaires français, menés entre 1960 et 1966 à Reggane et In Ekker, ont encore aujourd’hui « des effets désastreux sur l’homme et l’environnement ». Il a appelé la France à reconnaître officiellement sa responsabilité et à indemniser les victimes « de manière proportionnée à l’ampleur de la catastrophe ». Il a également insisté sur la nécessité de criminaliser le colonialisme, une démarche essentielle pour établir la vérité historique, honorer la mémoire des martyrs et condamner des pratiques qui ne devraient jamais être prescrites.
Les commémorations historiques ne suffisent pas à apaiser les tensions. Les contentieux mémoriels entre l’Algérie et la France restent vifs, notamment sur la question des essais nucléaires. Entre 1960 et 1966, la France a effectué 17 essais dans le Sahara algérien, à Reggane et In Ekker. Le premier essai, Gerboise bleue, en 1960, était trois fois plus puissant que la bombe d’Hiroshima, provoquant des retombées radioactives massives. Ces essais ont contaminé le sol, l’air et ont eu des conséquences dramatiques sur la santé des populations locales.
Une demande de réparation au plus haut niveau
Le 2 février 2025, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, dans une interview au journal français L’Opinion, l’urgence de l’indemnisation et de la décontamination des sites d’essais nucléaires français en Algérie. Il a souligné que « les réparations relatives aux explosions nucléaires et à l’utilisation d’armes chimiques par la France dans le Sud de l’Algérie sont un sujet indispensable pour la reprise de la coopération bilatérale », appelant à un règlement définitif de ces contentieux. Il a également insisté sur « la nécessité de connaître les périmètres exacts des essais nucléaires et l’emplacement des déchets nucléaires ».
Un héritage radioactif qui persiste
Dans son édition de février, la revue mensuelle de l’armée algérienne El Djeich a qualifié ces essais de « l’un des crimes les plus horribles de l’histoire de l’humanité », perpétrés par la France coloniale contre l’Algérie, laissant une tache indélébile sur l’histoire de la colonisation.
Un haut gradé de l’armée algérienne, le général Bouzid Boufrioua, chef de service du génie de combat du Commandement des forces terrestres, a publiquement appelé, en février 2021, la France à décontaminer les sites des essais et à indemniser les victimes. Cet appel renforce la demande de l’Algérie pour une action concrète et immédiate face à cette pollution radioactive historique.
Experts et historiens face au silence français
Kaan Devecioglu, expert en Afrique au Centre d’études du Moyen-Orient (ORSAM), a évalué en 2023 les effets des essais nucléaires français en Algérie. Dans une déclaration à l’agence turque Anadolu, il a estimé que les dommages environnementaux et les effets négatifs des radiations sur la santé humaine sont toujours d’actualité. Il a rappelé que l’Algérie exige la localisation des déchets nucléaires et des compensations pour les victimes, soulignant que la France a évité de verser des indemnités à 100 000 personnes directement ou indirectement touchées.
Selon l’agence de presse officielle algérienne APS, en 2012, les essais nucléaires de 1962 ont rendu malades au moins 30 000 Algériens. Les historiens algériens, comme Mohamed El Korso, insistent sur la nécessité de récupérer les archives pour mesurer les répercussions de ces essais. Il critique la loi Morin pour son manque de justice envers les victimes algériennes.
Mohamed Lahcen Zeghidi, chercheur en histoire, a déclaré lors d’une commémoration à la Radio Internationale d’Algérie (RAI) qu’il était « temps que la France assume sa responsabilité pénale concernant ses explosions nucléaires dans le Sahara algérien, qui sont l’un des plus grands crimes contre l’humanité ». Il a ajouté que la pollution radioactive « ne disparaît pas après un certain temps, mais ses effets s’étendent sur des milliers d’années ».
Pour l’historien Hosni Kitouni, il serait préférable de conditionner la réconciliation par la décontamination et la réparation. « Faut-il, devant cette obstination de la France à ne pas remplir ses obligations, faire de cette question une conditionnalité de la réconciliation préconisée par certains acteurs en France comme en Algérie ? On ne peut que l’espérer, car la France, les Algériens l’ont appris depuis 1830, n’a jamais su respecter ses engagements solennels », affirme-t-il.
Les voix des victimes : un appel à la justice
L’Association Taourirt des victimes des essais nucléaires dans la région de l’Ahaggar, représentée par Boubaker Ibbeh, dénonce les effets persistants de ces essais, évoquant les maladies et les malformations congénitales qui affectent encore la population. « Il ne s’agit pas de simples explosions nucléaires, mais de massacres relevant du crime contre l’humanité, comme en témoignent les impacts sur l’environnement et les conséquences sanitaires désastreuses », déclare-t-il. Il réclame une enquête internationale et une reconnaissance des souffrances endurées par les populations locales.
Dans la région de l’Ahaggar, de nombreux habitants souffrent de cancers et de malformations congénitales liées à la radioactivité. Aujourd’hui, ils réclament justice pour ceux qui sont « en sursis » de mort.
Vers une possible détente ?
Pour la politologue Louisa Hamadouche, une coopération concrète entre la France et l’Algérie sur la gestion des retombées des essais nucléaires pourrait contribuer à désamorcer les tensions bilatérales. Cependant, elle souligne que « l’impact risque d’être seulement conjoncturel et momentané, car les raisons profondes des tensions ne sont pas liées uniquement à la question du nucléaire. Le processus de normalisation des relations nécessite une révision profonde, qui ne semble pas à l’ordre du jour ».
Un passé qui ne passe pas
Les essais nucléaires français en Algérie restent une plaie ouverte, avec des conséquences sanitaires et environnementales qui perdurent. L’Algérie exige réparation, décontamination et reconnaissance de ce qu’elle considère comme un crime contre l’humanité. La balle est désormais dans le camp de la France pour engager des actions concrètes et apaiser ce contentieux historique.
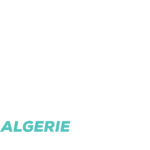








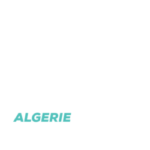




[…] À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de la première explosion nucléaire à Reggane, la question de la reconnaissance et de la réparation des victimes resurgit avec insistance. Deux figures majeures de l’État algérien, Salah Goudjil, président du Sénat, et Brahim Boughali, président de l’Assemblée populaire nationale (APN), ont vivement dénoncé l’héritage radioactif laissé par la France […] Read More […]