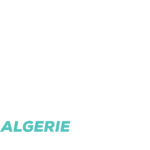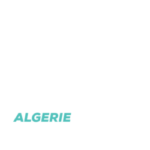La route transsaharienne, longue de près de 9 400 km, est bien plus qu’un simple projet d’infrastructure. Conçue comme un corridor transcontinental, elle relie six pays africains — l’Algérie, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Tunisie — dans un effort collectif pour favoriser l’intégration régionale et le développement économique du continent. Plus de 95 % de cette infrastructure sont déjà réalisés, selon les chiffres de la Banque africaine de développement (BAD). Pourtant, comme le souligne M. Ayadi, secrétaire général du Comité de la route transsaharienne lors de son passage à l’invité du jour de la chaine 3 de la Radio nationale, l’essentiel reste à faire : valoriser cette épine dorsale pour en faire un vecteur de croissance durable.
Une initiative historique pour l’intégration régionale
Conçu dans les années 1960 à l’initiative de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), ce projet visait à répondre à un besoin impératif : lutter contre l’isolement croissant des nouveaux États indépendants du continent. « La création de la route transsaharienne était une réponse à la fragmentation causée par les nouvelles frontières nationales. L’objectif était de permettre la libre circulation des biens et des personnes tout en promouvant les échanges commerciaux », explique M. Ayadi.
Depuis son lancement officiel dans les années 1971, notamment avec le tronçon reliant El-Golea à In Salah, initié par l’Algérie, le projet a su mobiliser des ressources considérables. L’Algérie, qui représente à elle seule plus d’un tiers du réseau total, a joué un rôle moteur en autofinancçant ses travaux. De son côté, le Nigeria a adopté une approche similaire, tandis que d’autres pays, comme le Mali et le Tchad, ont sollicité des financements internationaux.
Les défis de la valorisation
Malgré les progrès remarquables, le potentiel de la route transsaharienne reste sous-exploité. Selon M. Ayadi, « une infrastructure seule ne suffit pas. Pour aller vers une intégration régionale réelle, il faut des mécanismes qui facilitent les échanges et réduisent les coûts de transport ». Des études réalisées par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) ont démontré que les marchandises acheminées par cette route gagnent jusqu’à sept jours par rapport à un transit via le Golfe de Guinée.
Cependant, les pays du Sahel, moins dotés en infrastructures, rencontrent des difficultés pour exploiter pleinement ce potentiel. Les problèmes résident notamment dans la faiblesse des infrastructures routières locales et dans l’absence de réglementations harmonisées pour faciliter les flux commerciaux.
Vers une étude stratégique
Pour M. Ayadi, la solution réside dans une étude approfondie impliquant les ministères des Finances et du Commerce des six pays. « Il est indispensable d’identifier les potentialités économiques de chaque pays et de définir une stratégie commune pour valoriser les échanges. Nous devons faciliter les opérations des entrepreneurs et créer un cadre réglementaire incitatif », affirme-t-il.
Le NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique) pourrait jouer un rôle crucial en soutenant cette démarche. « L’Afrique dispose aujourd’hui d’une méthode de travail cohérente et structurée. Ce projet peut servir de modèle pour d’autres corridors de développement sur le continent », ajoute M. Ayadi.
Une vision d’avenir
En dépit des obstacles, la route transsaharienne représente une opportunité unique pour le continent africain. Elle peut non seulement favoriser les échanges économiques, mais aussi réduire les disparités régionales et renforcer la coopération entre les pays.
Cependant, comme le rappelle M. Ayadi, « il est anormal que des produits manufacturés viennent de Chine alors que nous avons la capacité de les produire et de les échanger au niveau régional. La route transsaharienne peut changer cette dynamique si nous savons en tirer parti ». Une ambition qui repose sur la volonté politique, l’engagement collectif et la mise en place de mécanismes adaptés pour transformer cette infrastructure en un véritable levier de développement.